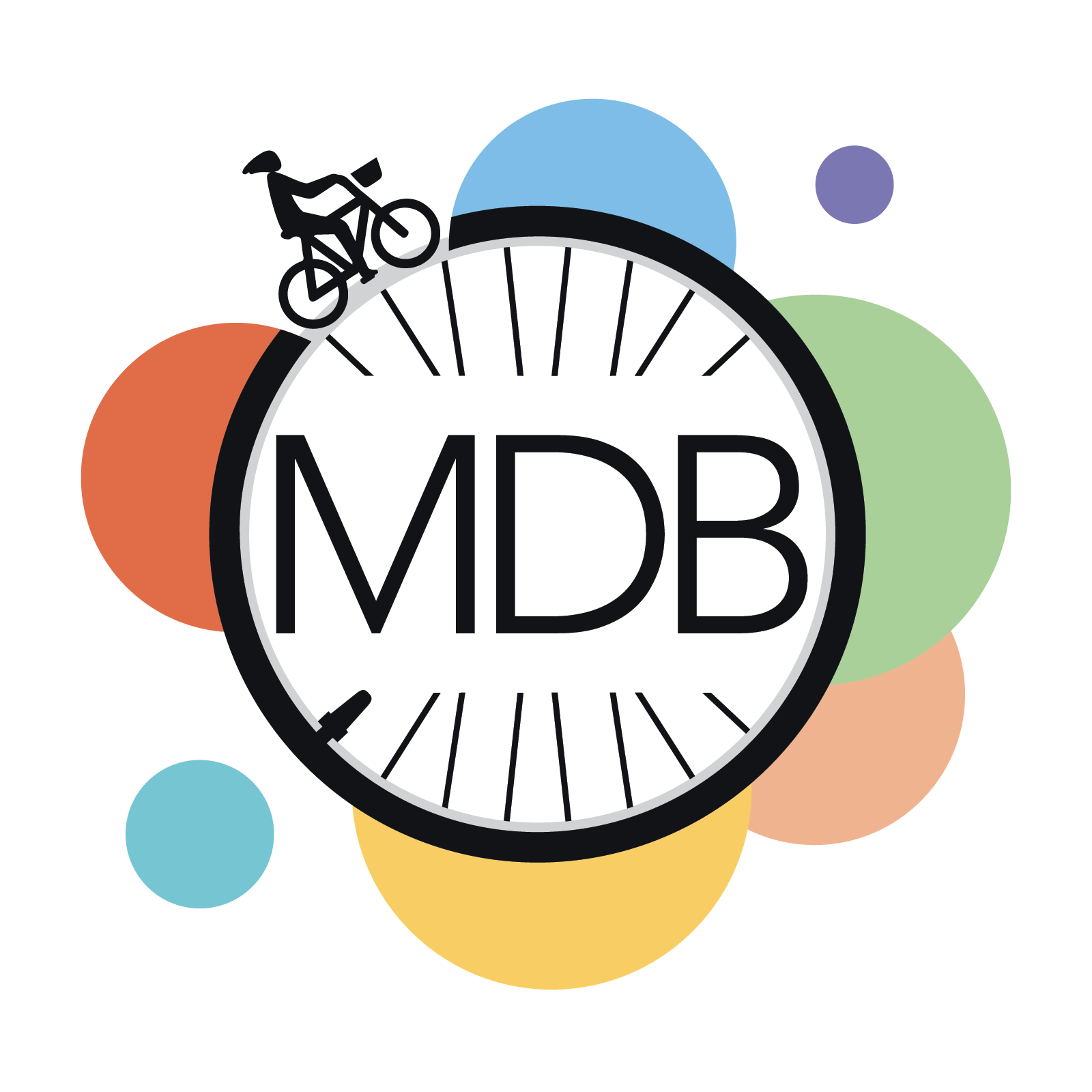Le Forum vies mobiles présentait, mardi 4 décembre à l’Académie du Climat, les résultats de son enquête sur la mobilité des Français·es en dehors des déplacements pendulaires. Car si notre perception de la mobilité tourne souvent autour du travail et des études, le temps libre est aussi générateur de déplacements et source d’inégalités de mobilité.
Quel temps libre ?
Temps libre : ce qu’on pourrait ne pas faire, c’est-à-dire ni i le travail, ni les déplacements de santé ou administratifs, ni les besoins physiologiques (dormir, se laver, etc).
Les Français·es disposent de 36h de temps libre hebdomadaire en moyenne, avec trois facteurs de disparités principaux :
- Le travail
- Les enfants (42h de temps libre pour les sans enfants, 28h pour les foyers avec enfants)
- Le genre : 41h de temps libre pour les hommes, 32h pour les femmes et un sentiment de satisfaction des hommes sur leur temps libre plus important : 52% de satisfaits, 47% de satisfaites
Proportionnellement, on constate que le temps de déplacement diminue de façon moins importante que les distances parcourues sur notre temps libre. Cela laisse à penser que lorsqu’on a le choix, on va plus lentement. Mais qu’est ce qui influe sur le fait d’aller loin ou pas sur son temps libre ?
Se déplacer sur son temps libre
L’enquête se place avec une volonté de territorialisation, pour une autre forme de représentativité qu’à la Convention citoyenne pour le climat (CCC). En effet, les habitudes de mobilité sont aussi très marquées territorialement. De plus, à la CCC, le Gouvernement donnait un objectif aux citoyen·nes membres. Ici, le Forum vies mobiles a demandé aux participant·es quels étaient leurs objectifs, pour trouver ensuite les solutions en phase avec ceux-ci et les impératifs écologiques. Mais alors, pourquoi veut-on se déplacer :
- avoir un temps libre plus continu et apaisé
- pouvoir profiter le soir et la nuit, avec les motifs de renoncement liés à l’offre de transport, aux substances (drogues ou médicaments)
- Pouvoir aller loin pour voir ses proches, participer à des événements culturels
- avoir des transports en commun fiables et efficaces
- pouvoir avoir une vie locale plus riche
Deux critères principaux régissent nos déplacements :
- le genre : les femmes vont moins loin, différence qui s’accentue avec l’arrivée des enfants, qui n’a que peu d’impact pour les hommes
- l’âge : il y a un « facteur enfants » et un facteur générationnel : les ancien·nes sont plus attaché·es à leurs quartiers
Même si la majorité des activités se font à moins de 20km, une large partie des Français est prête à aller très loin :
- pour retrouver ses proches
- pour les évènements culturels et festifs. À ce sujet, les demandes de nos associations pour les grands événements en Île-de-France permettent d’agir sur la facilité de se déplacer à vélo : stations Vélib’ éphémères avec la garantie de pouvoir prendre et restituer son vélo près de l’événement, grands parkings surveillés à Solidays ou lors des Jeux olympiques et paralympiques pour les vélos personnels ont permis de développer l’usage du vélo pour les grands événements parisiens. L’organisation de ces événements dans des lieux excentrés peut toutefois représenter un frein persistant. À ce titre, la délocalisation de la Fête de l’Huma en Essonne (à cause de l’organisation des Jeux Olympiques) à 30 minutes de marche de la gare de Brétigny (RER C), elle-même sujette à un service discontinu, représente un frein à l’utilisation d’alternatives à la voiture.
Table ronde
La présentation des résultats de l’enquête est suivie d’une table ronde avec Marie Pochon, députée (EELV) de la Drôme, Annelise Avril, directrice générale chargée des grands réseaux urbains chez Kéolis et Sébastien Mariani, secrétaire général de la Fédération générale Transports-environnement CFDT, membre du CESE.
Ce dernier y recontextualise la question du temps libre et de sa prise en compte chez nos voisins européens : Espagne, Portugal, Belgique ont différentes initiatives portées sur la réduction du temps de travail. Par ailleurs, le télétravail comme façon de “libérer du temps libre continu” marque de forte disparités générationnelles.
Il évoque également un temps libre “à protéger”, selon une définition juridique du temps libre par opposition à la définition par la négative en vigueur actuellement et utilisée dans cette enquête du Forum vies mobiles. Il faut aussi tenir compte du temps libre “à valoriser”, celui de l’engagement dans des associations par exemple.
Marie Pochon évoque la question du tout-voiture, centrale et à questionner, car elle construit du renoncement : si 40% des Français·es renoncent régulièrement à des déplacements, y compris des repas entre amis ou en famille, c’est notamment parce que :
- 10% de la population n’a pas le permis,
- que les plus jeunes et les plus âgés ne sont pas forcément aptes à la conduite,
- que les plus pauvres n’ont pas les moyens d’entretenir une voiture
- La forte utilisation de la voiture sans assurance posent de plus d’autres questions en matière de sécurité routière et de violences motorisées
Alors que le Grand Paris Express mobilise plus de 30 milliards d’euros d’investissement, le développement d’alternatives à la voiture en zones peu denses ne bénéficie que de 30 millions de financements à l’échelle nationale. La région parisienne trop dense concentre des difficultés pour celles et ceux qui s’y déplacent, mais s’accapare également les moyens financiers nécessaires à tout le territoire.
Symboliquement, les routes du Vercors sont devenues le foyer d’une mobilité pour la mobilité, avec le développement d’un tourisme de roadtrips, pendant que le transport à la demande pour les locaux est géré par des associations dépourvues de financements.
La directrice générale de Keolis rappelle pour sa part que le trajet-domicile n’est déjà pas si simple ; le mode de vie n’est plus aussi nettement fondé sur celui-ci. La précarité mobilité pour des raisons économiques va entraîner à des renoncements de mobilité ; sur le temps libre en priorité. Parmi les solutions envisageables, le transport à la demande a recours à des algorithmes pour améliorer le taux de groupage tout en préservant une durée d’attente et de course raisonnable. Anne-Lise Avril revient toutefois sur une expérimentation menée avec la SNCF sur 5 communes de la Sarthe. Avec 400 courses/mois dont 40% des bénéficiaires ne sont pas équipés de véhicules motorisés, c’est peut-être une solution pour sortir des personnes de la précarité mobilité et une alternative importante pour les autres.
La ville la nuit, c’est aussi la campagne. Si le transporteur aime les flux concentrés dans le temps et dans l’espace, la difficulté commence avec l’une ou l’autre des dispersions.
Plus d’informations
- Quelles solutions pour des mobilités durables et inclusives en zones peu denses ?, rapport de Sébastien Mariani pour le CESE
- La conférence de présentation des résultats de l’enquête en intégralité, sur Youtube