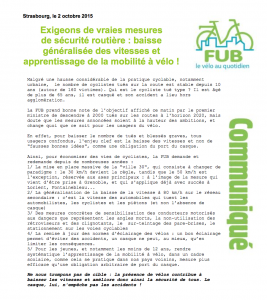
Communiqué de la FUB
Malgré une hausse considérable de la pratique cyclable, notamment urbaine, le nombre de cyclistes tués sur la route est stable depuis 10 ans (autour de 160 victimes). Qui est le
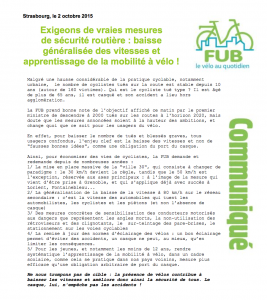
Malgré une hausse considérable de la pratique cyclable, notamment urbaine, le nombre de cyclistes tués sur la route est stable depuis 10 ans (autour de 160 victimes). Qui est le

Article paru dans Roue Libre n°110 (juillet-août 2009) Par Pierre Toulouse et Francis Papon Le 28 mai dernier s’est tenue à Lyon une rencontre des chercheurs français sur le thème
Bonjour, Je suis contre l’ « obligation de casque », mais aussi contre la « promotion de casque », et contre la « recommandation de porter un casque » et autres « conseil de porter un casque », « pression
Campagne « jamais de vélo sans casque » Une lettre de la présidente de la FUBicy (Fédération des Usagers de la Bicyclette) à M. Pierre GOGIN FPS – Fédération Professionnelle

Le casque Un débat entre cyclistes Par Abel GUGGENHEIM Débat sur la liste de diffusion vélo de la FUBicy en juillet 2002 Que pensez-vous de la proposition de rendre le

Le casque Utile… indispensable… obligatoire ? Par Xavier CHAVANNE et Pierre TOULOUSE Ce printemps 2002 un message publicitaire télévisé, commandé par l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé,